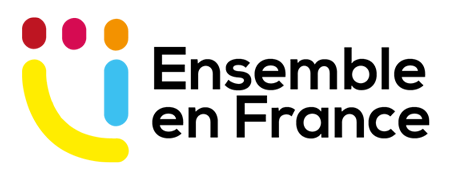D’où vient la laïcité ?
Beaucoup croient qu’être « laïque », c’est être contre les religions, qu’elles soient musulmanes, juives, chrétiennes ou bouddhistes. L’histoire même du mot « laïcité » prouve le contraire.
Laïcité vient de « laïque », du latin « laicus » qui signifie « commun, ordinaire ». Il vient aussi du grec « laikos », c’est à dire le peuple, par opposition à « clericos », le clerc, l’homme d’église.
Le « laïc » c’est donc l’homme ordinaire qui n’appartient pas à la sphère religieuse savante. Rien n’empêche pourtant le laïc d’être croyant. Étymologiquement, laïcité ne veut donc pas dire s’opposer aux religions, aux croyances. Dans la réalité non plus.
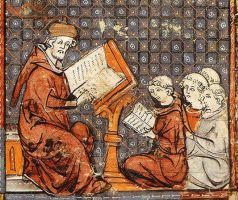
Pendant longtemps l’enseignement se donnait dans les abbayes, les monastères : seul les membres du clergé, les religieux transmettaient le savoir.
L’expression ironique courante « il n’y a pas besoin d’être un grand clerc pour… » signifie « il n’y a pas besoin d’être un grand savant pour… »
Une république laïque qu’est-ce que c’est ? C’est une gouvernance tenue à l’écart des religieux, des « clericos », ou de ceux qui envisagent le monde sous le prisme de la foi. C’est la loi des Hommes, celle des élus du peuple, du « laikos », qui s’impose à l’ensemble des citoyens. La loi de Dieu reste dans la sphère intime des croyants. Libre à celui qui croit de suivre les règles dictées par sa foi, si elles ne troublent pas l’ordre public.
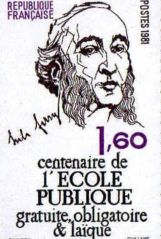
Avec Jules Ferry, à la fin du XIXe, l’instruction devient obligatoire, gratuite et laïque pour les filles et les garçons.
Avec une « instruction morale et civique » et non plus « religieuse » enseignée à l’école publique, l’État affirme sa neutralité.
La religion trouve sa place dans la sphère privée : un jour libre, outre le dimanche, est laissé aux élèves pour recevoir des cours de catéchisme, en dehors de l’école.
Suivre la loi des Hommes, c’est garantir la neutralité de l’État face à toutes les croyances. C’est permettre l’égalité de traitement entre les citoyens. Pourvoir suivre la loi de son Dieu dans son intimité, c’est une liberté : celle de pratiquer son culte, de changer de religion, de choisir de croire ou de ne pas croire.
Être laïque, ce n’est pas être contre les religions. C’est être pour la Liberté, l’Égalité, et le respect de chacun en toute Fraternité.
Aller plus loin
- Voir les courtes vidéos de témoins étrangers et d’experts à propos de la laïcité sur la chaîne You tube d’Ensemble en France. Elles sont sous-titrées en arabe, en anglais et en allemand.
- Traduire le mot « laïcité » est compliqué. Son équivalent n’est pas vraiment le « secularism » anglo saxon, ni même le « almanya » ou « ilmanya » arabe. Razika Adnani nous explique les mésaventures autour des tentatives de traduction du mot » laïcité » en langue arabe et les confusions qu’elle génère.